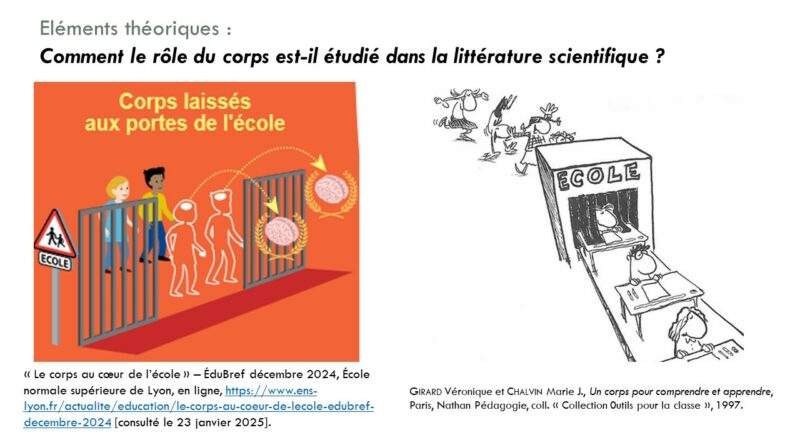[JNF 2025, Atelier 4] La place du corps dans les apprentissages et les processus de mémorisation
Quand j’ai vu le sujet des JNF de cette année, je me suis dit que l’on parlait souvent des apprenants auditifs ou visuels, mais peu des kinesthésiques (même si les études en neuroscience sont controversées, on reconnait tout de même différents modes d’apprentissage, et le consensus porte sur le fait que nous serions plurimodaux).
Je me suis rendue compte que, inconsciemment, de manière intuitive, je prenais en compte cet aspect de l’apprentissage autant que les autres.
On peut dire que penser au corps en formation, c’est d’abord être attentif au besoin de mouvement des étudiants, mais aussi inventer des mises en situation de travail réalistes.
Le but est de permettre l’interaction entre corps, cerveau et environnement, pour permettre de stimuler la mémoire dans la durée.
L’atelier a été séquencé en différents temps : 1) un brainstorming avec le groupe entier ; 2) à partir de ce premier temps, une réflexion en sous-groupes ; 3) une présentation de mes réflexions ; 4) quelques apports théoriques. Les productions ont constitué les supports de restitution pour l’après-midi.
La première partie de l’atelier a consisté en un temps en commun, autour de cette question : quels éléments sont à prendre en compte quand on aborde le rôle du corps en formation ? Quels sont les besoins ?
Penser au corps, c’est penser à celui des étudiants, celui des formateurs, mais aussi, plus précisément, aborder les notions de gestion de l’espace, de la posture, du regard et du geste.
Ensuite, un temps en sous-groupe a permis de réfléchir à comment ces éléments pouvaient se traduire en choix pédagogiques. Les participants étaient invités à proposer leurs idées en graduant les solutions d’un monde idéal à ce qu’on peut mettre en place facilement.
Puis, j’ai parlé de ma propre expérience et de l’attention portée à cette problématique.
Les étudiants sont tenus de rester immobiles pendant des heures, parfois dans des amphithéâtres peu confortables : comment prend-on en compte cette donnée ? On est soi-même assis et bloqué, souvent, à cause des moyens de sonorisation, ou à cause d’autres contraintes, et cela amène à se demander :
- dans quelle position je forme : comment je me sens quand je reste assise ? Pour bien former, je fais attention à mon propre bien-être.
- comment je gère les contraintes de mobilier : et si j’hérite d’une salle non adaptable, comment je fais ? Le placement des élèves et la facilité d’accès du formateur dans l’espace ont une incidence sur la façon dont les tâches sont organisées et réalisées.
- former en étant malade : comment je peux faire abstraction de mon corps fatigué ?
Une piste pour la prise en compte du corps est un intérêt que l’on porte déjà à nos formations en augmentant l’interactivité et en allant jusqu’à la ludification, que ce soit en TD ou en amphi. On peut alterner rapidement les démonstrations et applications, pour conserver un rythme de phases de manipulation. Elaborer un jeu permet d’être actif : un escape game ou une visite ludifiée remplissent cette fonction d’être en mouvement. Il faut néanmoins prendre en compte les étudiants qui ont des difficultés de santé qui les obligent à ne pas rester debout longtemps.
En terme d’activités, il y a des petits trucs et astuces : classer les étapes de la recherche documentaire grâce à des papiers à remettre dans le bon ordre, et en discuter ; reconnaitre le type de document à partir d’une référence bibliographique avec un tableau contenant différentes cases et les éléments à remettre au bon endroit ; répondre grâce à des cartons de vote ; quand il y a des manipulations, faire lever un étudiant pour corriger au poste maître. Toutes ces stratégies sont utiles, sans nuire aux autres formes d’apprentissage.
On peut apprendre à développer et maintenir une attention particulière qui permet de détecter les étudiants réticents, ceux qui ne suivent pas, ceux qui sont hostiles, ceux qui s’ennuient, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont intéressés etc
De plus, utiliser son propre corps de formateur est important pour rythmer le propos. Je me suis rendue compte que je me déplaçais consciemment quand je changeais de partie, afin de séquencer le contenu et de marquer les transitions, en me disant que l’on pouvait se souvenir de ce que je disais quand j’étais de tel ou de tel côté de l’écran, ou que je faisais des gestes sur le tableau et l’écran projeté. Je fais attention à ma place dans l’espace : où je donne les consignes (pour qu’on me voie et m’entende bien), où je me déplace pendant les activités de groupe.
A l’opposé, il y a des choses que je refuse de faire, comme passer derrière les étudiants lors des phases de manipulation. J’évite ainsi d’entrer dans leur zone d’intimité. Je ne me déplace que s’ils lèvent la main et m’interpellent.
Il faut également garder en mémoire que les étudiants se placent là où ils sont le plus à l’aise dans la salle, sans qu’il y ait nécessairement une hostilité à l’égard du formateur. Ne faisons pas en sorte, en faisant se déplacer les étudiants pour répondre à son propre confort, de leur faire passer le cours le plus long et le plus désagréable de leur semaine.
Un autre point de tension est peut être que nos formations se déroulent en one shot (on ne connait pas les étudiants, on ne les voit qu’une fois) : quelle énergie mettre dans cette attention à cette forme particulière d’apprentissage alors que tout le monde est plurimodal, et donc plus ou moins visuel ou auditif ?
Et en visio, comment on fait ? Je n’ai pas de réponse, et je n’ai pas lu d’éléments sur ce sujet dans la littérature scientifique à laquelle j’ai eu accès. Mais on peut penser que des exercices pratiques permettent aussi de rythmer nos formations à distance, ou même en allant jusqu’à faire se lever les étudiants et chercher un document dans la pièce où ils se trouvent, ou bien éteindre ou allumer leur caméra pour répondre à des questions.
Au final, et pour résumer, quand je prépare une formation, et même si je ne le note pas dans les supports, je suis attentive à différents points : ma position dans l’espace pour appuyer mon propos, ma position dans l’espace pour remobiliser l’attention, le regard pour être attentive à ce qui se passe, les sensations corporelles pour sentir le groupe (et qui sont difficiles à expliquer à un formateur novice).
Enfin, quelques aspects théoriques ont été abordés, en visitant ce thème via la littérature scientifique.
Le dossier de l’IFE n°126 de novembre 2018, s’interroge : “La question du corps à l’école parait souvent négligée dans la littérature de recherche. Corps des élèves et corps des enseignant.e.s sont pourtant indissociables des personnes qu’ils incarnent : les « esprits » ne se promènent pas tous seuls dans la cour de récréation ni dans la salle des professeur.e.s. Pourquoi dès lors, le corps, malgré toutes évidences, ne semble-t-il pas plus central dans les préoccupations scolaires et didactiques ?” “Cette absence de questionnement sur la place du corps à l’école est en elle-même une information significative […]”
Cette réflexion existe pour les élèves du premier degré, un peu pour le secondaire (pour les cours artistiques ou ceux qui, de fait, font appel au corps comme le théâtre ou l’EPS), avec le biais de la gestion des espaces à l’université dans les travaux de groupe, mais c’est très rare.
Du côté des enseignants, l’intérêt du corps se situe principalement dans la posture et la gestion de sa voix, pour éviter de la fatiguer.
Jean-François Moulin, dans “Le discours silencieux …”, paru dans les Carrefours de l’Education n°17 de janv-juin 2004, indique : “La qualité du langage corporel de l’enseignant conditionne pour une grande partie l’efficacité de son activité d’enseignement et donc la transmission de son propos didactique”.
Il nous amène à nous interroger sur cette idée : est-ce que “la maitrise de la communication non verbale” serait “une des clés de l’autorité du maitre ?”
Dans le livre Le corps au coeur des apprentissages, on trouve une nomenclature des gestes, qui peuvent nous aider à conscientiser nos mouvements et nous invite à nous entrainer à porter une attention particulière à nos mains, sans toutefois charger notre propos de gestes parasites :
- gestes extracommunicatifs : annexes au propos, à éviter (ex : faire craquer ses phalanges)
- gestes prosodiques : intéressants car ponctuent le propos (ex : rythmer les groupes de sens d’une phrase, accentuer, remobiliser)
- gestes déictiques (ex : désigner un élève) : ce peut aussi être les gestes descriptifs (ex : montrer une partie de l’écran, attirer l’attention)
- gestes iconiques : soutenir le sens des mots (ex : symboliser les opérateurs booléens avec ses mains)
- gestes emblèmes (ex : lever le pouce pour valoriser)
- expression faciale et sourires.
Dans la littérature scientifique, on retrouve également une nomenclature pour la voix. On joue sur le timbre, le volume, la modulation, le débit :
- voix didactique : qui explique un cours. On a une façon professorale de parler, et les étudiant.e.s savent la reconnaitre.
- voix de communication : qui permet l’échange avec un groupe entier.
- voix adressée à une personne : pour interroger ou relancer le propos.
- voix affectivisée : permet de créer un univers de confiance.
Le regard aussi peut se définir de différentes manières :
- regard panoptique : qui surveille.
- regard de la communication : pour échanger et relancer.
- regard bienveillant.
- attention au regard trop insistant que les étudiants voudront esquiver.
- attention : les non-regardés sont démobilisés.
Pour résumer, on peut dire que cette question traverse la réflexion : est-ce que le corps fait partie de l’être à éduquer ou est-ce qu’il l’accompagne simplement ? Est-ce qu’on laisse son corps à la sortie de la classe pour n’être que des cerveaux bien rangés ?
BIBLIOGRAPHIE
– Marie-Charlotte Allam, Marie Chartier, « Modifier l’aménagement de la classe pour le bienêtre des élèves : vers une forme scolaire flexible ? », Raisons éducatives, 27.1, 2023, p. 131‑151.
– Archiclasse, « De l’importance du corps et de la posture des apprenants », Archiclasse, 2018, en ligne, https://archiclasse.education.fr/De-l-importance-du-corps-et-de-la-posture-des-apprenants, consulté le 5 février 2025.
– Fanny Auzéau, « Le corps : un allié de l’enseignant souvent oublié », Synergies France, 10, 2016, p. 83‑90.
– Sandrine Bourrain, Vincent Dupayage, Marjorie Nadal, Gaëlle Walgenwitz, Maud Corvaisier, Damien Tessier, Joëlle Aden, Le corps au coeur des apprentissages: faire cours (un peu) autrement, Presses universitaires de Grenoble (éd.), Fontaine, France, PUG, 2021.
– Hélène Duval, Caroline Raymond, Delphine Odier-Guedj, Caroline Charbonneau, Citlali Jimenez, Domenico Masciotra, Engager le corps pour enseigner et apprendre : diversité de perspectives, Paris, France, Canada, Hermann, 2022.
– Marie Gaussel, « Que fait le corps à l’école ? », Dossier de veille de l’IFE, 126, 2018, en ligne, https://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?p%20arent=accueil&dossier=126&lang=fr, consulté le 5 février 2025.
– Véronique Girard, Marie-Joseph Chalvin, Marc Chalvin, Un corps pour comprendre et apprendre, Paris, France, Nathan pédagogie, 1997.
– Jean-Rémi Lapaire, « Le « corps apprenant » : une notion centrale en mal d’inclusion », in Engager le corps pour enseigner et apprendre, s. d., p. pp 277-302.
– « Le corps de l’enseignant : gestes, voix et postures », en ligne, https://calenda.org/207983, consulté le 5 février 2025.
– Anne Leymaris-Selles, « La voix : instrument à cordes originel », in Vanier Véronique, Corps et pédagogie : accord perdu entre le corps et le savoir ?, Paris, France, ADAPT Éditions, 2004.
– Jean-François Moulin, « Le discours silencieux du corps enseignant : La communication non verbale du maître dans les pratiques de classe », Carrefours de l’éducation, 17.1, 2004, p. 142‑159.
– Véronique Vanier, « Le corps en pédagogie », Diversité, 160.1, 2010, p. 15‑18.